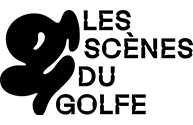Les Insulaires
Nina BouraouiLes Insulaires
Nina Bouraoui
Nous étions dans l’espace et nous subissions l’espace. Nous ne pouvions nous en départir, il encerclait notre être. Depuis notre naissance, nous avions accepté, assimilé sa forme qui faisait loi, reproduite sur les pages de notre atlas géographique. L’espace, c’est-à-dire le monde, notre monde, avait l’aspect d’un globe scellé parfois à un pied : globe lumineux qui brillait dans les ténèbres de l’enfance et élargissait nos rêves ; nous le faisions pivoter avec un sentiment de puissance et de fragilité – tant de territoires inconnus, tant de conquêtes en vue, tant de distances aussi : nous nous tenions éloignés les uns des autres, assignés au rôle de l’étranger ou à celui de l’ennemi.
Les continents étaient bien séparés - terre explosive et explosée, les lignes étaient bien brisées, les limites bien marquées, nul ne devait venir envahir la part de l’autre, chaque géographie se repliait sur elle-même, comme un corps qui a froid ou qui a peur.
La disposition de notre monde était simple, le Nord et le Sud, les glaciers et les brasiers, les richesses et les déserts mortifères en réponse ; la terre se scindait, les peuples avec ; quand je dis « les peuples, » je pense à nous tous qui les constituons, sans en avoir toujours conscience. Nous tous, à demi libres pour les uns, nul ne sachant quand commence et quand s’achève la liberté, prisonniers à plein temps pour les autres, sous l’emprise d’un Etat, d’une religion, du malheur économique. Nous tous, en marche, en joie et en souffrance, semblables et égaux (en théorie) pris dans une course que personne ne remporterai. Si l’on ne se lie pas, ensemble n’existe pas et les triomphes restent des défaites. Défaite de l’amour, défaite de la solidarité, défaite du regard qui, sitôt tourné vers l’extérieur, se rabat vers soi.
Nous avons pensé l’espace en tant qu’espace clôt, chacun dans son couloir, chacun sur sa ligne, chacun dans son vide impossible à combler, l’infini ne se recouvre pas.
Nous étions si petits sur la carte du monde car nous étions si seuls : sans toi, je ne suis pas moi, sans vous, nous n’est pas.
Il faut tant de force pour réunir le Nord et le Sud, tant de foi pour croire en un peuple unique et précieux. Il faut tant de patience pour combler les creux qui séparent les continents. Il faut tant d’espérance pour comprendre que demain se construit au présent et que la solidarité est une action juste et un devoir dans le sens qu’Emmanuel Kant lui donne quand il évoque la bonne volonté.
Dans ma jeunesse, je n’aimais pas la ville. La vérité surgissait de la nature, de la mer, prodigieuse, elle seule ouvrait l’horizon conduisait à l’Autre, vers l’Autre. Elle seule me faisait entendre que nous avions un destin commun, que nos frontières étaient mentales, faussées.
Nous étions des habitants des récifs et non des cités, nous étions des voyageurs et non des sédentaires, nous étions des naufragés, des rescapés, des passagers du vaisseau-terre qui survivrait à notre déclin, vengé d’avoir été ainsi dévoré.
Dès les beaux jours, je me rendais, à quatre vingt kilomètres d’Alger sur un rocher protégé par une forêt de roseaux, posé sur l’eau, blanchi par le sel, poli par les vagues, les vents, aux soubassements pointus, coupants, habillés d’algues et de coquillages, lisse en surface sous mes pieds nus quand je le traversais avant de me jeter dans la méditerranée profonde, agitée, folle et vénéneuse – mon corps immergé dans son corps, corps soumis, corps guerriers, nous nous affrontions de longues minutes durant ; une fois vaincue, je remontai sans force sur la plateforme, ivre d’être en vie, dans la vie, dense et nerveuse, vie mêlée à la grande vie : la mer reliait deux royaumes, l’Afrique et l’Europe vers laquelle je nageais, glissais, croyant parfois la frôler ; je communiais : communion des éléments, communion des deux pans qui me constituaient.
La mer devenait un territoire, mon territoire, moi l’enfant de France et d’Algérie que l’histoire opposait. J’y voyais le symbole d’un monde parfait, un monde que l’on ne peut ni fragmenter, ni dissocier. Je me sentais d’un seul pays qui devenait à son tour corps flottant sur l’eau abyssale, future Atlantide, beau car éphémère à l’image du plaisir, de la félicité que j’y puisais.
J’étais une et composée, la nature me liait à ceux qui me ressemblaient, le peuple des Hommes, mes siamois qu’il me fallait retrouver, reconnaître puis étreindre. Nous étions d’un seul arbre. Nous étions d’une seule peau.
Sans le savoir je pénétrais la projection de Richard Buckminster Fuller, architecte, qui, en 1954 avait imaginé, pensé, conçu, un planisphère différent de celui que nous avions l’habitude de consulter pour savoir qui et où nous étions et surtout, peut-être, qui et où nous n’étions pas ou ne serions jamais.
Sa projection dite Icosaèdre en raison des vingt rectangles dont les faces composaient la représentation inédite de notre espace-monde, affirmait l’immensité de l’océan. Elle abolissait les frontières, les axes, les hémisphères, mêlant le sud au nord, les vivants aux vivants.
L’eau étirait son empire. Fuller scellait les continents.
Le monde devint une île, ses habitants des insulaires. La nouvelle terre penchait, se redressait, vrillait puis, immobile enfin se regardait de l’intérieur vers l’intérieur ; hors d’elle, le bleu régnait, veillait et disait l’infiniment grand et l’infini petit : nul n’est supérieur, chaque épaule se touche, chaque main se serre, chaque visage est un miroir. Il ne s’agissait pas d’une fantaisie. Il ne s’agissait pas d’un conte. Il s’agissait d’un avertissement.
Nos frontières sont des barricades, notre indifférence est une arme, nos silences font le lit des guerres. Nous avons perdu l’Autre. Nous avons perdu ses yeux. Nous avons perdu son souffle chaud et les battements de son cœur. Nous avons perdu la force de ses idées et les raisons de sa peur. Nous avons perdu la grâce de son mouvement et la douleur de sa chair quand il est blessé, humilié. Nous avons perdu ses mots et sa parole. Nous avons perdu son talent et sa richesse. Nous avons perdu ce qui en lui nous rendait meilleurs. Nous avons perdu nos réponses à ses questions. Nous avons perdu l’Autre car nous nous sommes perdus. La lumière s’est enfuie. La nuit est tombée sur la terre et ses maisons, sur la mer et les bateaux qui la défient.
Je crois en l’influence de la beauté sur nos esprits quand elle devient climax. Je crois en la poésie quand elle tombe en pluie fine sur nos mains ouvertes pour la recueillir. Je crois en la souveraineté de l’Art qui rassemble. Je crois au désir quand il abandonne sa force négative. Je crois en la naissance d’un nouveau monde que je chanterai avec mon prochain.
Nina Bouraoui
[Les Insulaires est un texte écrit tout spécialement par Nina Bouraoui pour les Emancipéés, en mars 2020]